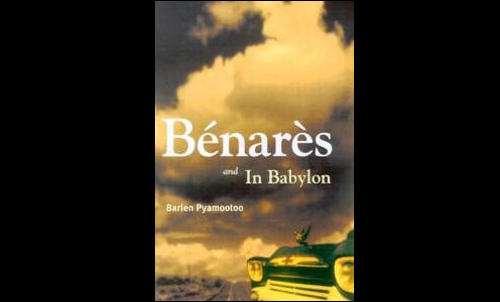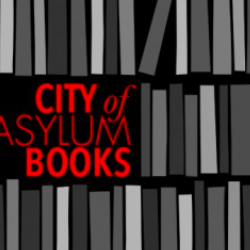Barlen Pyamootoo: Bénarès (French Text)
by Sampsonia Way / January 2, 2013 / No comments
Sampsonia Way is pleased to be able to share the writing of Barlen Pyamootoo, who is participating in a short-term residency with City of Asylum/Pittsburgh. Pyamootoo is from Trou d’Eau Douce, Mauritius and is the author of three novels: Bénarès, Salogi’s, and Le tour de Babylone. He is also the founder of two publishing houses: Alma and L’Atelier d’écriture. Before his residency with COAP, Pyamootoo was a writer-in-residence at the University of Iowa’s International Writing Program.
Below is the first chapter of Pyamootoo’s novel Bénarès in the original French, published by Les éditions de l’Olivier in 1999.
Un jour, Mayi est venu à la maison. J’habitais en face de la boutique, ça ne faisait pas longtemps. Ma maison n’avait qu’une pièce, mais elle avait une cour qui l’agrandissait quand on ouvrait la porte et la fenêtre, et au milieu de la cour, un arbre se déployait, qui cachait le ciel et le soleil et donnait de l’ombre toute la journée, c’était agréable quand il faisait chaud. Un chemin de terre bordait la cour, il était fréquenté par les amoureux et ceux qui s’en allaient fumer leurs joints ou qui en revenaient, le chemin menait à la mer et à une plage qui était vaste et discrète. Il était aussi fréquenté par des hommes qui buvaient, mais eux ne bougeaient pas, ils restaient collés à la boutique, qui était loin de la mer. Et plus loin encore se trouvaient le dispensaire, le bureau de poste et des maisons dont plusieurs étaient inhabitées depuis longtemps, puis il y avait un immense champ de cannes qui donnait l’impression de couper le village en deux, et suivaient en file indienne l’école, la maison de mes parents et celle de Mayi.
Le jour se levait quand j’ai aperçu Mayi, il longeait le champ de cannes en traînant les pieds et en baissant les yeux, il semblait réfléchir à quelque chose de profond, d’important. J’ai pensé à son métier dès que je l’ai vu, je venais de me raser et je m’habillais pour aller au travail. On disait pour se moquer de lui qu’il était un pêcheur de deuxième division: il ne pêchait pas au-delà du lagon, à cause des remous qu’il ne supportait pas. Il s’est arrêté devant le bureau de poste et s’est retourné. Le soleil continuait à monter et à s’étendre, tandis que la route balafrait tout le village comme un décor de fond peint, silencieuse et immobile et profonde aussi : elle semblait avoir coulé, sombré. Mayi a sorti un mouchoir de sa poche et il s’est essuyé le visage avec un soin minutieux, comme s’il se démaquillait devant un miroir, se caressait : il donnait l’impression de se regarder en même temps. Puis il s’est remis à marcher tout en évitant le soleil. Par moments il s’arrêtait brusquement ou ralentissait son allure et disait un mot à des gens que je ne voyais pas, mais que j’imaginais accoudés sur le bord de la fenêtre ou assis sur le pas de la porte. La route descendait en lacets, bordée de chaque côté de petites maisons en bois et en tôle ondulée. J’ai quitté la fenêtre quand Mayi a dépassé le dispensaire et je me suis assis sur le lit pour enfiler mon pantalon. Quand je me suis levé, il avait déjà poussé la porte de la maison. Il est resté un moment sur le seuil, le visage levé vers le plafond. Il semblait en étudier la texture, il avait l’air si sérieux, si studieux. Puis il s’est rapproché de moi, il avait des yeux qui dormaient, un peu perdus, et il m’a demandé une cigarette. Il en a tiré une très longue bouffée et il a renversé la tête en arrière pour rendre la fumée, par le nez et par la bouche, et ça a duré longtemps. C’était étrange comme ses yeux éclairaient son visage à mesure qu’il rendait la fumée et qu’elle montait au plafond. Quand il n’avait plus de fumée à rendre, il a éteint la cigarette et il s’est mis à tousser. Il a glissé deux doigts dans la poche de son short, en a sorti un mouchoir qui était sale et chiffonné et il s’est essuyé le nez, la bouche et tout le visage. Puis il m’a fait un sourire qui le rendait encore plus beau : la veille, il avait gagné deux mille roupies aux cartes et il voulait qu’on ramène chacun une femme à la maison, pour cette nuit.
Je suis rentré du travail vers cinq heures. Mayi m’attendait. Il était adossé à la porte de ma maison et il fumait. C’était nerveux, il l’a dit lui-même en écrasant sa cigarette. Il portait de beaux habits, c’était la première fois que je le voyais en chemise et en pantalon, je l’avais toujours connu en short et en maillot de footballeur. Il paraissait plus vieux, plus distingué. Je lui ai rappelé d’un ton sec que le taxi ne viendrait qu’à six heures. Ce n’était pas qu’il m’ennuyait, mais j’étais tendu et fatigué et j’avais envie d’être seul un moment, le temps d’oublier le travail. Mayi a détourné son regard vers la boutique et a laissé échapper un murmure où seul le mot “sûr” était compréhensible, puis il m’a fixé de nouveau et il a haussé les épaules : “C’est tout.” Alors il est rentré chez lui, il repasserait à six heures. J’ai pris une douche et je me suis lavé les cheveux. J’ai mis un jean et un T-shirt avec “ Miami” écrit dessus. J’aime les vêtements où il y a quelque chose à lire, c’est ce que je lis le plus.
Mayi et Jimi sont arrivés en même temps. Quand je ramenais une femme à la maison, c’était toujours Jimi que je prenais comme chauffeur, il avait des manières qui me plaisaient beaucoup, quand il s’adressait aux gens par exemple, il ne s’attachait qu’au fond des choses. Nous sommes partis tout de suite. J’étais assis à côté de Jimi, Mayi était à l’arrière, juste derrière moi. Il ne parlait pas, peut-être ça l’intimidait de faire une route pareille, c’était la première fois. Je me retournais de temps en temps, je voulais m’assurer que tout allait bien, qu’il ne s’ennuyait pas. Il contemplait à chaque fois le ciel et il paraissait tout ému. Nous sommes arrivés à Port-Louis un peu avant sept heures. Nous avons tourné dans pratiquement toutes ses rues et nous sommes allés jusqu’au port et à plusieurs reprises, mais nous n’avons croisé que des hommes. Il était trop tôt. Jimi a alors proposé de nous emmener à Pointe aux Sables. Il nous a dit qu’il y avait là-bas des femmes qui se tenaient à chaque coin de rue et qu’il n’avait jamais vu ça ailleurs, autant de femmes à la fois : “Vous en prenez deux et on rentre à la maison.” Nous avons fait cinq fois le tour du village, et ce n’est qu’au dernier tour que nous avons vu une femme. Elle était à un arrêt d’autobus, en compagnie d’un homme qui devait être son maquereau. Elle nous a fait signe de nous arrêter et elle nous a demandé : “Vous cherchez des femmes?” Je lui ai répondu qu’on en cherchait deux. Elle a dit que c’était facile à trouver. J’ai précisé que c’était pour emmener à la maison. Elle a voulu savoir où. J’ai dit à Bénarès. Ça l’a refroidie sur-le-champ. Elle a fait un pas en arrière, s’est retournée brusquement et a rejoint son maquereau à l’arrêt d’autobus. C’est lui qui nous a dit : “C’est trop loin, Bénarès, elle ne connaît même pas.”
“Ce n’est pas si loin que ça…”, mais il n’a pas dû m’entendre, un autobus s’est interposé au même moment, couvrant ma voix. Deux femmes en sont descendues. Il ne restait plus que le chauffeur, qui était pressé. Il a attaqué la côte à toute vitesse, tandis que les deux femmes embrassaient le maquereau à tour de rôle. C’était un long baiser à chaque fois. Il y a eu des rires, puis ils ont tous quitté l’arrêt d’autobus. Au bout de quelques pas, le maquereau s’est retourné et nous a fait un signe de tête, d’encouragement je crois. Je l’ai salué de la main et j’ai regardé sans regret les femmes qui peinaient pour gravir la côte. On aurait dit trois barriques qui risquaient à chaque pas de se renverser et de dévaler la pente à tombeau ouvert.
“Et maintenant”, a demandé Jimi, et il a lancé à Mayi un coup d’oeil par en dessous, “qu’est-ce qu’on fait?”
Mayi ne lui a pas répondu. Il a continué à se ronger les ongles, sans se presser. Il semblait perdu dans un rêve, il avait un regard qu’on a quand on laisse flotter ses pensées, évanescent, quelque chose comme ça. Il méditait sûrement. Il était accoudé à la portière et il regardait au loin. Il donnait l’impression de s’élever à travers le toit de la voiture jusque dans le ciel, peut-être à cause de la route qui descendait en pente raide. Le ciel était d’un gris monotone. Probablement la mer l’était elle aussi et tout ce qu’il pourrait voir en bas s’il se penchait davantage. Mais il ne regardait qu’en haut, le ciel gris et monotone.
Plusieurs fois, j’ai cru percevoir des pas et des rires et une rumeur confuse qui ressemblait à un chant, mais aussi loin que j’ai pu voir, les rues restaient désespérément vides. Alors j’ai fini par gueuler à pleine voix : “Mais qu’est-ce qu’elles foutent?”, et j’ai regardé ma montre comme si nous avions rendez-vous. Il était tard, presque huit heures.
“J’ai vu un bateau au port tout à l’heure”, a dit Jimi. “Un tout gros et tout rouillé… Peut-être qu’il est arrivé aujourd’hui.”
“Et ça change quoi?”, je ne comprenais pas où il voulait en venir.
“Ça expliquerait pourquoi on ne voit pas les femmes”, et il a regardé vers les arbres qui bordaient l’autre côté de la rue et vers le ciel au-dessus. “Elles ne commenceront pas la partie sans les marins, puisque ce sont eux qui vont pousser les enchères”, et il s’est retourné lentement, a allumé une cigarette à l’abri du vent, “et elles vaudront cher cette nuit, parce que rares.”
“Et à quelle heure elle va commencer, cette partie?”
Jimi a longuement regardé sa montre, il a dû compter les heures et les minutes, puis il a redressé la tête et m’a souri d’un air gêné : “Pas de sitôt, les marins sont pris ailleurs et pour un bon bout de temps.”
“Des bagarres?”
Jimi a balancé ses bras à la manière d’un boxeur et il a rigolé : “Juste de quoi ne pas se rouiller.”
“ Qu’est-ce qu’on fait?”, j’ai demandé à mon tour.
Mayi se rongeait toujours les ongles, il avait juste changé de main, et il avait le même regard qu’avant, mais tourné à présent vers les champs, les maisons, la mer. On voyait le port, mais pas le gros bateau. J’ai failli le dire à Jimi, mais je me suis rendu compte à temps qu’on ne voyait pas tout le port.
Jimi a répondu sur un ton neutre : “Allons chez Ma Tante.”
Je ne connaissais pas Ma Tante, mais on m’avait souvent parlé d’elle et de sa maison qui était fermée la nuit, parce que les femmes qu’elle employait avaient un mari et des enfants qu’elles retrouvaient le soir après le travail. Et bien sûr que les maris étaient au courant, mais ils fermaient les yeux, ils étaient trop pauvres pour refuser de l’argent ou trop gourmands. On m’avait aussi parlé des lits qu’il y avait dans les chambres et dont le sommier était en béton. Pour qu’ils ne se cassent pas, m’avait-on expliqué, avec tous ces hommes qui bougent de trop. Puis j’ai repensé à Ma Tante et à sa maison qu’elle fermait la nuit, je me disais que c’était sûrement parce qu’elle avait un mari elle aussi. “Mais on ne va pas la déranger?”, j’ai demandé à Jimi en lui tirant le bras pour qu’il se retourne. “Parce que c’est fermé la nuit.”
“Mais c’est juste pour nous dépanner”, a dit Jimi d’une voix douce mais ferme, “nous donner une adresse, et même si elle ne le peut pas, au moins ça fera passer le temps, en attendant que les marins aient fini de se battre.”
Nous avons retraversé Port-Louis. On aurait dit une ville en guerre, pas une femme n’était visible dans ses rues. Juste des chiens et quelques hommes qui semblaient attendre un même couvre-feu, le signal pour se séparer, se disperser. Puis nous avons pris la direction de Sainte Croix, où nous avons tourné à droite après une station-service et roulé une centaine de mètres sur une route qu’on goudronnait, il y avait des panneaux un peu partout qui l’indiquaient. “On dirait de la réclame”, a mur-muré Jimi, et il s’est penché vers moi et m’a demandé : “Des élections?” Je lui ai répondu que je n’en savais rien, mais que ça m’étonnerait, je n’avais vu aucune affiche qui en parlait. “Moi, c’est ça qui m’étonne”, a dit Jimi, “qu’il n’y ait pas d’affiches justement.” Il semblait en chercher quand il a ralenti. Il y en avait bien quelques-unes, mais c’était pour le cinéma. Jimi a marmonné quelques mots que je ne comprenais pas, qui paraissaient d’une autre époque, puis il s’est arrêté devant une maison qui était illuminée et qui avait un jardin avec des roses de plusieurs couleurs. C’était sûrement pour les roses qu’il y avait de la lumière au-dessus de chaque porte et de chaque fenêtre : pour ne rien perdre de leurs couleurs. Un sentier traversait le jardin, il était droit et étroit et tellement propre qu’il brillait autant que les roses. J’ai regardé la maison et je me suis figuré les personnes qui y habitaient et quelques métiers qu’elles pouvaient exercer. Peut-être travaillaient-elles dans une banque ou dans un ministère, peut-être étaient-elles dans les affaires. Et j’ai réfléchi à d’autres métiers, moins répandus, mais surtout j’ai pensé combien elles avaient raison d’aimer les roses. Des gens bien comme on dit, et je ne comprenais pas pourquoi Jimi s’était arrêté devant leur maison.
“Pourquoi tu t’arrêtes ici?”
“C’est ici qu’habite Ma Tante”, m’a répondu Jimi.
“Tu en es sûr?”, et j’ai longuement regardé le jardin, ses fleurs et son sentier qui brillaient. Chaque rose déployait son halo de clarté comme une pierre précieuse, et je pouvais distinguer sans peine les moindres nuances des teintes, mais il m’était impossible de désigner par des mots l’infinie diversité des jaunes, des blancs et des rouges.
“C’est ici même”, a dit Jimi, et il est descendu de la voiture. Il nous a attendus pour claquer les portières en même temps que nous. “Pour ne faire du bruit qu’une fois”, nous a-t-il expliqué.
Nous avons traversé le jardin en suant et en marchant comme des somnambules, à petits pas cadencés, silencieux. Il y régnait une chaleur qui portait au sommeil. “On se croirait dans une serre”, j’ai dit à Jimi qui avait sorti son mouchoir. C’était un drôle de mouchoir, d’un modèle que je ne connaissais pas : il était brodé et à peine plus large que la paume d’une main. Il a tamponné son visage et ses avant-bras avec, puis il l’a soigneusement plié en quatre avant de le remettre dans sa poche : “C’en est peut-être une après tout, avec toutes ces fleurs, toutes ces lumières.” Il s’est arrêté devant la porte d’entrée et il a appelé : “Ma Tante ! Ma Tante!”
On a ouvert la porte tout de suite et une femme plutôt âgée est apparue sur le seuil. C’était Ma Tante, telle qu’on me l’avait décrite, obèse avec un visage en lame de couteau. Elle avait les lèvres épaisses, les épaules larges, et ses bras et ses jambes se dressaient droits comme autant de poutres pleines et robustes. Ses cheveux étaient noirs et bouclés et ses seins volumineux bombaient dans une blouse d’un brun aussi foncé que celui de sa peau. Elle avait la bouche ouverte, sans doute ravie de la visite. J’ai essayé de deviner son âge, sans y parvenir. Son visage était sillonné de rides, mais ses yeux étaient restés aussi clairs que ceux d’une jeune fille. Ils m’ont paru encore plus jeunes quand elle a reconnu Jimi : des lueurs y ont soudain brillé, aussi furtives qu’un feu follet. Elle a saisi la main que lui tendait Jimi et s’est blottie un long moment contre lui, puis elle nous a embrassés, Mayi et moi, en nous serrant en même temps dans ses bras. Elle avait beaucoup de force, on m’avait dit qu’elle frappait les hommes qui ne payaient pas ou qui cherchaient la bagarre.
“Mais entrez donc”, a dit Ma Tante en désignant la porte, et elle nous a précédés dans une pièce qui était située à l’arrière de la maison. Ça a été un choc terrible, tellement ses couleurs contrastaient avec celles du jardin : la pièce n’était pas peinte et le crépi de ses murs avait pris la teinte du moisi, c’était un mélange de vert, de gris et de marron, et en plus elle sentait le ciment. Heureusement que la fenêtre était ouverte, un vent faible mais continu traversait toute la pièce avant de se briser dans un bruissement régulier contre des posters à moitié décollés. On n’y distinguait plus grand-chose, des seins peut-être, ou étaient-ce des fesses? Il y avait aussi quelques fauteuils cannés tout autour d’une table basse où étaient disposés en cercle des verres en plastique, avec au milieu deux cendriers, un vieux magazine, des prospectus d’un hôtel à Rodrigues et un miroir fêlé. Avant de s’asseoir, Jimi a sorti une topette de rhum d’une des poches de son pantalon et il a retourné quatre verres. Mais Ma Tante lui a dit qu’elle ne buvait plus que le dimanche, à cause de son coeur qui galopait. Jimi a quand même rempli son verre : “C’est pour dimanche”, et il a remis la topette dans sa poche. Il lui a donné des nouvelles de Bénarès et de ceux qu’elle ne voyait plus, “parce qu’ils n’ont plus le temps”, a-t-il répondu, “ou quand ils l’ont, c’est le soir déjà, c’est trop tard”. Il lui a parlé des choses qui ont changé, de son métier, de l’hôtel où il faisait des remplacements et des touristes qui y passaient leurs vacances : il y avait des Allemands, des Français, des Italiens et d’autres encore mais moins nombreux, et il a dit combien il se sentait drôle au milieu de tous ces blancs qui lui parlaient si gentiment, il n’avait jamais vu ça, des gens qui posaient autant de questions. “C’est étrange”, a-t-il murmuré, et il s’est essuyé pensivement le front avec son mouchoir, “c’est comme sur une autre planète…” Après un silence qui m’a paru long et pesant, il a dit à Ma Tante qu’on cherchait deux femmes et que c’était pour emmener à la maison. Puis il a ajouté : “Et demain de bonne heure, je les raccompagne chez elles.”
“Pourquoi vous n’allez pas chez Maman?”, a dit Ma Tante avec un soupir, et elle a regardé d’un air désoeuvré les posters, le sol, les verres et les fauteuils vides.
Excerpt from Bénarès, by Barlen Pyamootoo. Published by Les éditions de l’Olivier, 1999. Used with permission of the author. All rights reserved.